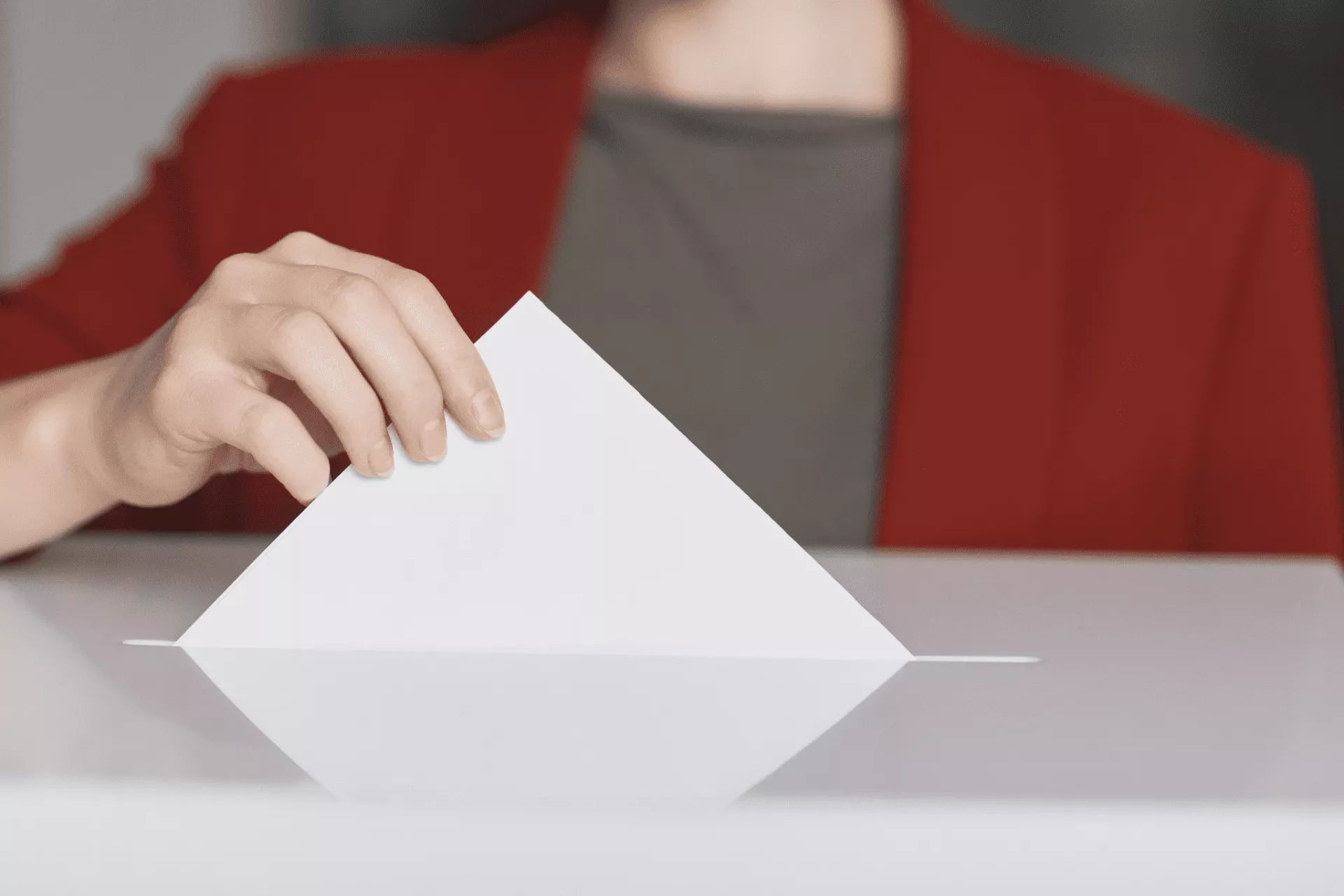Comment redonner envie de voter aux Genevois?
La participation électorale s’effrite à Genève. Avec à peine 28% de votants lors des dernières votations cantonales, le canton atteint un plancher historique. Lassitude civique, complexité des objets soumis au vote, manque de clarté ou décalage avec les usages numériques : les causes sont multiples. Comment, dès lors, redonner envie aux Genevois de glisser un bulletin dans l’urne et de renouer avec cet acte démocratique fondamental ?
Vingt-huit pour cent seulement. Tel est le taux de participation enregistré lors des dernières votations cantonales à Genève. Il s’agit d’un niveau historiquement bas : il faut remonter à 1999 pour observer une participation aussi faible. Ce recul intervient alors même que les objets soumis au vote (développement de l’énergie solaire et réforme des impôts communaux) concernaient des projets structurants pour le canton.
Ce phénomène ne constitue pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une tendance plus générale. Lors des élections municipales de 2025, seuls 84’000 électeurs sur près de 290’000 se sont rendus aux urnes, soit moins d’un tiers du corps électoral. Un taux en baisse par rapport aux scrutins de 2015 et 2020.
Quant aux votations fédérales, le constat est comparable. Genève se positionne dans le bas du classement national de la participation : 23e canton en 2021, 21e en 2022, 17e en 2023, 20e en 2024. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Le canton occupait encore la 3e place en 2019, et se situait au 9e rang sur la période 2011–2020.
Une participation moyenne de 45%
Pour mieux comprendre ce recul, il convient de revenir sur l’évolution de la participation au cours des dix dernières années. À Genève, le taux de participation moyen s’élève à 45,3%, avec des pics notables en 2016 et 2021, mais aussi des creux marqués en 2018, 2019, 2023, et un plancher historique atteint en mai 2025.
Ces variations s’expliquent en partie par la nature des objets soumis au vote. Les scrutins les plus mobilisateurs sont souvent ceux à portée nationale, clivants et fortement médiatisés. Ce fut le cas, par exemple, en 2016 avec l’initiative sur le mariage, en 2018 avec « No Billag », en 2020 avec les votes sur l’immigration, les avions de combat et le salaire minimum à Genève, ou encore en 2024 avec la réforme de l’AVS.
Ces scrutins partagent un socle commun : des enjeux clairs, une large exposition médiatique, une dimension symbolique marquée et un impact concret pour la population. À l’inverse, les objets plus techniques, moins visibles ou perçus comme éloignés des préoccupations immédiates, peinent à susciter le même intérêt.
« L’acte de voter a peu évolué face aux usages numériques d’aujourd’hui »
Pourquoi vote-t-on moins ?
La baisse de la participation électorale invite à s’interroger : qu’est-ce qui pousse (ou empêche) les citoyens à voter ? Plusieurs raisons peuvent être avancées. Tout d’abord, la lisibilité : certains objets soumis au vote sont complexes, peu expliqués, ou rédigés dans un langage jugé trop technique. Ensuite, la confiance : si les électeurs doutent que leur vote ait un réel impact, ils se mobilisent moins. Enfin, la proximité : plus un objet semble éloigné de la vie quotidienne, moins il suscite d’intérêt.
À cela s’ajoute un facteur propre à Genève : la fréquence des scrutins. Depuis 2000, les électeurs genevois ont voté sur plus de 200 objets cantonaux, soit le total le plus élevé en Suisse. Une fréquence de votations aussi accrue, bien qu’elle reflète une forte culture participative, peut générer une certaine lassitude et affaiblir l’engagement.
Il y a aussi la forme : l’acte de voter a peu évolué face aux usages numériques d’aujourd’hui. À l’ère des applications et des messages instantanés, la procédure peut paraître dépassée, en particulier pour les plus jeunes.
Stimuler la participation
Face à cette réalité, plusieurs leviers doivent être envisagés. Le premier est celui de la clarté : simplifier les documents de vote, mieux structurer les explications, rendre l’information plus accessible. Le second est celui de l’éducation : renforcer, dès l’école, la compréhension des institutions et du rôle que joue chaque citoyen dans la décision publique. Le troisième est celui des médias : en tant qu’éclaireurs, ils ont la responsabilité de poser les termes des débats, d’en clarifier les enjeux et de synthétiser l’information, afin de nourrir un espace public avisé et pluraliste.
Il ne s’agit pas seulement de faire remonter le taux de participation. Il s’agit de raviver un geste démocratique essentiel, et peut-être, d’oser le réinventer. À l’heure où les usages évoluent, ne devrait-on pas repenser aussi nos pratiques démocratiques ? L’enjeu n’est pas de tout changer, mais de tester, d’ajuster, et surtout de redonner envie.